
Juil 5, 2023 | Non classifié(e)
Le samedi 24 juin 2023, un séminaire théologique s’est tenu à Loppiano (Incisa Valdarno, Florence), sur le thème « Participer/Présider/Décider. Racines sacramentelles et dynamiques de communion dans le parcours du peuple de Dieu en mission ». Plus de trente chercheurs ont répondu à l’invitation du Centre Evangelii Gaudium (CEG) de l’Institut universitaire Sophia pour élaborer une proposition de révision du droit canonique afin de rééquilibrer – comme l’exhorte le document de base (Instrumentum laboris) de la XIVe Assemblée du Synode des évêques – « le rapport entre le principe d’autorité, fortement affirmé dans la législation actuelle, et le principe de participation ». Puisque « toutes les discussions doctrinales, morales ou pastorales »,  assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? » Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la
assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? » Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la  conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.
conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.
Antonio Bergamo
Juin 30, 2023 | Non classifié(e)
Au Japon, un groupe de femmes de différentes religions a mis sur pied le “Projet CommuniHeart”, un projet de prévention du suicide, axé sur la conscience de soi, la communication et le soutien d’une communauté. Le Projet CommuniHeart est un projet promu par ‘’Religions pour la Paix’’ Japon (Conférence Mondiale des Religions pour la Paix). https://youtu.be/pRf6Q_gNlYU

Juin 27, 2023 | Non classifié(e)
Le niveau atteint par les intelligences artificielles nous pose de nouvelles questions éthiques : comment promouvoir un développement technologique respectueux de l’homme ? Call to action (Appel à l’action) pour les développeurs et les innovateurs du monde numérique. Un horizon qui nous concerne tous.
Juin 2023, Institut universitaire Sophia : sur l’écran de l’Aula Magna, une hôtesse numérique ouvre élégamment le séminaire « Towards a Digital Oath / Vers un serment numérique ». Nous franchissons un seuil : les préparatifs sont en cours depuis un certain temps, mais  l’accélération de ces derniers mois dit quelque chose de nouveau. Promu par une plateforme d’acteurs – le centre de recherche Sophia Global Studies, le Movimento Politico per l’Unità, NetOne, New Humanity et Digital Oath -, la rencontre vise à aborder les questions les plus urgentes du monde numérique sous différentes perspectives : philosophique, technologique, éthique, social, politique, jusqu’à discuter de la proposition d’un « serment » qui pourrait représenter quelque chose d’analogue au serment d’Hippocrate des médecins pour ceux qui travaillent dans le monde numérique. D’où vient ce besoin ? Avec quels objectifs ?
l’accélération de ces derniers mois dit quelque chose de nouveau. Promu par une plateforme d’acteurs – le centre de recherche Sophia Global Studies, le Movimento Politico per l’Unità, NetOne, New Humanity et Digital Oath -, la rencontre vise à aborder les questions les plus urgentes du monde numérique sous différentes perspectives : philosophique, technologique, éthique, social, politique, jusqu’à discuter de la proposition d’un « serment » qui pourrait représenter quelque chose d’analogue au serment d’Hippocrate des médecins pour ceux qui travaillent dans le monde numérique. D’où vient ce besoin ? Avec quels objectifs ?
Le monde technologique tend à changer rapidement et, de plus en plus, à une vitesse qui dépasse notre capacité d’adaptation. La complexité des machines et des systèmes qui structurent la réalité affecte non seulement notre façon de vivre, mais aussi notre façon de voir le monde et de penser l’avenir. Le niveau atteint par les « intelligences artificielles »- IA, voit l’émergence, à côté de l’enthousiasme pour leurs capacités opérationnelles, d’une inquiétude générale quant aux nouvelles possibilités ouvertes par ces systèmes et aux effets qui peuvent résulter de leur utilisation malveillante.
 La diffusion récente du ChatGPT (novembre 2022) et de tous ses dérivés a massivement rapproché les IA de notre vie quotidienne, soulevant de nouvelles questions de sens liées à la compréhension de ce qui est humain et de ce qui ne l’est pas. Sur la scène mondiale, l’évolution de ces dispositifs a produit une certaine désorientation, non seulement parce que leur utilisation semble être à la portée de tous, mais surtout parce qu’ils démontrent qu’ils font quelque chose qui était auparavant l’apanage des êtres humains, avec des capacités quantitativement supérieures. Le fait que nous soyons confrontés à des systèmes qui ne sont pas « intelligents » au sens humain du terme et qui gèrent leur base de connaissances par des calculs statistiques ne change rien au résultat final : le sentiment de ne plus être les auteurs de choix fondamentaux, concurrencés par des machines qui sont un peu moins des « outils » et un peu plus des « compagnons de travail ».
La diffusion récente du ChatGPT (novembre 2022) et de tous ses dérivés a massivement rapproché les IA de notre vie quotidienne, soulevant de nouvelles questions de sens liées à la compréhension de ce qui est humain et de ce qui ne l’est pas. Sur la scène mondiale, l’évolution de ces dispositifs a produit une certaine désorientation, non seulement parce que leur utilisation semble être à la portée de tous, mais surtout parce qu’ils démontrent qu’ils font quelque chose qui était auparavant l’apanage des êtres humains, avec des capacités quantitativement supérieures. Le fait que nous soyons confrontés à des systèmes qui ne sont pas « intelligents » au sens humain du terme et qui gèrent leur base de connaissances par des calculs statistiques ne change rien au résultat final : le sentiment de ne plus être les auteurs de choix fondamentaux, concurrencés par des machines qui sont un peu moins des « outils » et un peu plus des « compagnons de travail ».
A ces questions, le séminaire « Vers un serment numérique / Towards a Digital Oath » a ajouté un thème central : s’interroger sur l’éthique des technologies, c’est s’interroger sur l’humain. En effet, nombreux sont ceux qui considèrent le développement technologique comme l’activité humaine qui nous caractérise le plus. En effet, les technologies numériques, et en particulier l’IA, sont celles qui reflètent plus que d’autres, comme dans un miroir, notre façon d’être et de comprendre l’existence. Les crises du siècle dernier (valeurs, environnementales, sociales et politiques) leur sont étroitement liées et nous disent que le développement technologique doit s’accompagner d’un engagement éducatif tout aussi déterminé, afin que toutes les formes de progrès puissent être guidées par une conscience éthique plus profonde. Le sens d’un « serment » pour le monde numérique va précisément dans ce sens. Le programme des premiers jours de juin a réuni des experts qualifiés (lien vers le programme). Après une première présentation générale des technologies numériques actuelles, le débat a porté sur les risques et les réglementations liés à leur utilisation en Italie et dans l’UE, aux États-Unis, au Brésil et en Chine, mêlant solutions technologiques et questions politiques, réflexions philosophiques et phénomènes sociaux. 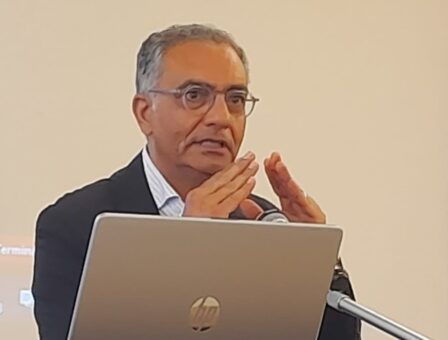 « Il est nécessaire de rendre visible et de souscrire à un engagement concret et universellement partagé », explique Fadi Chehadé, ancien PDG de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et promoteur du « serment » pour une éthique du monde numérique, professeur invité à l’Institut Sophia, « avec lequel les développeurs, les techniciens et les utilisateurs des technologies numériques peuvent fermement ancrer leur travail sur une approche centrée sur l’humain ». Fadi Chehadé a accompagné les premières étapes du parcours depuis novembre 2019, lorsqu’un premier groupe s’était réuni à Trente (Italie) pour donner forme au projet. Par la suite, le groupe promoteur a impliqué des chercheurs de différents pays et a participé à la consultation publique promue par l’ONU pour le Global Digital Compact 2024.
« Il est nécessaire de rendre visible et de souscrire à un engagement concret et universellement partagé », explique Fadi Chehadé, ancien PDG de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et promoteur du « serment » pour une éthique du monde numérique, professeur invité à l’Institut Sophia, « avec lequel les développeurs, les techniciens et les utilisateurs des technologies numériques peuvent fermement ancrer leur travail sur une approche centrée sur l’humain ». Fadi Chehadé a accompagné les premières étapes du parcours depuis novembre 2019, lorsqu’un premier groupe s’était réuni à Trente (Italie) pour donner forme au projet. Par la suite, le groupe promoteur a impliqué des chercheurs de différents pays et a participé à la consultation publique promue par l’ONU pour le Global Digital Compact 2024.
Aujourd’hui, l’objectif du Digital Oath est précis : suggérer des lignes directrices et motiver éthiquement les développeurs et les innovateurs du monde numérique à se concentrer sur la dignité et la qualité de vie des personnes et des communautés, sur le sens humain de l’existence et sur le respect des droits fondamentaux et de l’environnement. « La proposition de traduire, pour ainsi dire, le Serment d’Hippocrate pour le monde numérique », rappellent les promoteurs de la conférence, « est déjà apparue dans diverses études internationales, qui soulignent l’urgence de la question et la responsabilité de ceux qui créent et gèrent des services numériques et administrent des données. On pense non seulement aux nouveaux réseaux neuronaux, mais aussi aux réseaux sociaux, ou aux crypto-monnaies… Notre travail rejoint celui d’autres réseaux : il s’agit maintenant d’unir nos efforts pour une coalition entre universités, le secteur privé et les organisations engagées dans la rédaction d’un code d’éthique, d’un protocole d’autorégulation dont des personnes, des sociétés et l’environnement pourront bénéficier ».
Une première formulation du serment est disponible pour tous sur le nouveau site web du Digital Oath et les inscriptions affluent ; le texte est ouvert aux suggestions et aux modifications avec une élaboration progressive. Le site inclura également bientôt les enregistrements et les documents du Séminaire. Bien que le chemin soit certainement ascendant, nous sommes nombreux à marcher : c’est un horizon qui nous concerne tous. Andrea Galluzzi

Juin 23, 2023 | Non classifié(e)
La Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe a tenu sa quinzième session plénière du 1er au 7 juin 2023 à Alexandrie (Égypte), accueillie par le Patriarcat grec orthodoxe d’Alexandrie et de toute l’Afrique, et est parvenue à un accord sur un nouveau document intitulé « Synodalité et primauté au deuxième millénaire et aujourd’hui ». Notre entretien avec le théologien Piero Coda, présent à la réunion. Mgr Coda, pouvez-vous nous dire ce qu’a été cette rencontre, qui y a participé et quel était son objectif principal ? Il s’agissait de la 15ème session plénière de la « Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe » qui s’est tenue à Alexandrie, en Égypte, sous la présidence du Métropolite Job de Pisidie (Patriarcat œcuménique de Constantinople) et du Cardinal Kurt Koch (Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens), avec l’hospitalité cordiale du Patriarche Théodoros II d’Alexandrie. Il s’agissait de compléter la phase de dialogue inaugurée par le document de Ravenne (2007), qui prévoyait, après la mise au point du cadre théologique commun aux orthodoxes et aux catholiques sur l’interdépendance dans la vie de l’Église de la synodalité et de la primauté, l’examen historique de la situation vécue au premier millénaire, proposé par le document de Chieti (2016), pour arriver à la description de la situation vécue au deuxième millénaire, objet du document approuvé à Alexandrie. En raison des vicissitudes bien connues qui agitent le monde orthodoxe, le Patriarcat de Russie a abandonné les travaux de la Commission. Les représentants des Patriarcats d’Antioche, de Bulgarie et de Serbie étaient également absents d’Alexandrie, tandis que les 10 délégations restantes des autres Patriarcats (Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, Roumanie, Géorgie) et des Églises autocéphales (Chypre, Grèce, Pologne, Albanie, Tchécoslovaquie et Slovaquie) étaient présentes. Dans quels termes peut-on parler de synodalité dans la sphère œcuménique et quelles sont les considérations qui se dégagent du passé ?  Le thème est illustré dans l’introduction : « Le présent document considère l’histoire troublée du deuxième millénaire (…) il s’efforce de donner autant que possible une lecture commune de cette histoire et offre aux orthodoxes et aux catholiques l’occasion de s’expliquer mutuellement sur divers points, afin de promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles qui sont des conditions préalables essentielles à la réconciliation au début du troisième millénaire. » Il en résulte une compréhension plus claire et plus partagée des motifs qui ont conduit – souvent pour des raisons de nature historico-politique plutôt que théologique – à favoriser une distance qui a non seulement empêché les tentatives de réconciliation au cours des siècles de porter leurs fruits, mais qui a exacerbé les interprétations polémiques envers l’autre partie et le durcissement apologétique de sa propre position. Il faut noter que l’ouverture à une situation nouvelle marquée par le rapprochement opéré au XXème siècle est à valoriser : elle favorise une évaluation plus pertinente de la signification réelle et du poids théologique de ce qui fait encore obstacle à l’unité pleine et visible. Quelles sont les perspectives d’avenir ? Le document souligne que le “retour aux sources” de la foi et la stratégie du dialogue de la charité entre les “Églises sœurs” promues, dans le sillage de Vatican II, par Paul VI et le Patriarche Athénagoras sont décisifs. L’engagement actuel de l’Église catholique, poursuivi avec ténacité par le pape François, de redécouvrir et de réactiver le principe de synodalité stimule également l’espoir. Dans quelle direction allons-nous ? Le document souligne que « l’Église n’est pas correctement comprise si on la voit comme une pyramide, avec une primauté la gouvernant d’en haut, mais elle n’est pas non plus correctement comprise si on la considère comme une fédération d’Églises autosuffisantes. Notre étude historique de la synodalité et de la primauté au cours du deuxième millénaire a montré l’inadéquation de ces deux visions. De même, il est clair que pour les catholiques, la synodalité n’est pas simplement consultative et que pour les orthodoxes, la primauté n’est pas simplement “honorifique “.» L’interdépendance entre synodalité et primauté, donc – c’est le point établi -, est « un principe fondamental dans la vie de l’Église. Elle est intrinsèquement liée au service de l’Église aux niveaux local, régional et universel. Cependant, le principe doit être appliqué dans des contextes historiques spécifiques (…) Ce qui est requis dans de nouvelles circonstances, c’est une application nouvelle et correcte du même principe. » Cette perspective ouvre la voie à la poursuite du voyage et à l’ouverture d’une nouvelle phase.
Le thème est illustré dans l’introduction : « Le présent document considère l’histoire troublée du deuxième millénaire (…) il s’efforce de donner autant que possible une lecture commune de cette histoire et offre aux orthodoxes et aux catholiques l’occasion de s’expliquer mutuellement sur divers points, afin de promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles qui sont des conditions préalables essentielles à la réconciliation au début du troisième millénaire. » Il en résulte une compréhension plus claire et plus partagée des motifs qui ont conduit – souvent pour des raisons de nature historico-politique plutôt que théologique – à favoriser une distance qui a non seulement empêché les tentatives de réconciliation au cours des siècles de porter leurs fruits, mais qui a exacerbé les interprétations polémiques envers l’autre partie et le durcissement apologétique de sa propre position. Il faut noter que l’ouverture à une situation nouvelle marquée par le rapprochement opéré au XXème siècle est à valoriser : elle favorise une évaluation plus pertinente de la signification réelle et du poids théologique de ce qui fait encore obstacle à l’unité pleine et visible. Quelles sont les perspectives d’avenir ? Le document souligne que le “retour aux sources” de la foi et la stratégie du dialogue de la charité entre les “Églises sœurs” promues, dans le sillage de Vatican II, par Paul VI et le Patriarche Athénagoras sont décisifs. L’engagement actuel de l’Église catholique, poursuivi avec ténacité par le pape François, de redécouvrir et de réactiver le principe de synodalité stimule également l’espoir. Dans quelle direction allons-nous ? Le document souligne que « l’Église n’est pas correctement comprise si on la voit comme une pyramide, avec une primauté la gouvernant d’en haut, mais elle n’est pas non plus correctement comprise si on la considère comme une fédération d’Églises autosuffisantes. Notre étude historique de la synodalité et de la primauté au cours du deuxième millénaire a montré l’inadéquation de ces deux visions. De même, il est clair que pour les catholiques, la synodalité n’est pas simplement consultative et que pour les orthodoxes, la primauté n’est pas simplement “honorifique “.» L’interdépendance entre synodalité et primauté, donc – c’est le point établi -, est « un principe fondamental dans la vie de l’Église. Elle est intrinsèquement liée au service de l’Église aux niveaux local, régional et universel. Cependant, le principe doit être appliqué dans des contextes historiques spécifiques (…) Ce qui est requis dans de nouvelles circonstances, c’est une application nouvelle et correcte du même principe. » Cette perspective ouvre la voie à la poursuite du voyage et à l’ouverture d’une nouvelle phase.
Carlos Mana e Maria Grazia Berretta (photos: ©Dicastero per la promozione dell’Unità dei cristiani)
Juin 22, 2023 | Non classifié(e)
Entrer dans la prière signifie retrouver le coeur de la rencontre entre le “moi” et la présence de Dieu dans notre vie. Chiara Lubich, Pasquale Foresi et Igino Giordani, avec des mots qui, aujourd’hui deviennent toujours plus actuels, tracent les lignes d’une spiritualité civile, accessible à tous, vécue dans les rues des villes du monde entier.
Je me suis rendu compte que l’époque moderne demande une prière un peu particulière. […]. Autrefois on pensait que le monde et le cosmos étaient immobiles, fixes. L’homme devait donc trouver Dieu à travers les étoiles, à travers les fleurs, […] donc à travers la contemplation, la paix, l’union à Dieu, dans des moments de recueillement, de prière à l’Église, devant le Saint Sacrement… […] À présent, en revanche, on voit que le monde évolue, qu’il se transforme : tout change. […] L’homme est entrainé dans ce mouvement, il est engagé dans cette course vers la perfection. Alors il ne peut plus rester immobile à contempler, l’homme est appelé, […] à participer avec Dieu à cette évolution, à cette création. C’est pourquoi tout ce que vous faites à l’école, au bureau, à l’usine, revient à construire le monde avec Dieu créateur, faire évoluer le monde. Cependant nous devons le faire évoluer en ayant bien conscience que nous participons à la Création de Dieu, et donc que notre Œuvre est une œuvre sacrée. Nous sommes un bras de Dieu créateur qui va de l’avant, qui construit le monde.
Chiara Lubich (Castel Gandolfo, 25 février 1989 dans “le souffle de l’âme” préparé par Fabio Ciardi, Nouvelle Cité, 2023, p.66)
Une forme de prière très importante, on peut l’avoir au travail. Je pense surtout aux ouvriers dans les usines, à toutes les personnes qui, durant la journée, sont exténuées, avec une fatigue qui enlève presque la faculté même de penser et donc, dans un certain sens, de prier. Si le matin, par une simple intention, nous offrons notre vie quotidienne à Dieu, nous vivons profondément, durant toute la journée en relation avec Dieu. Et selon moi, lorsque le soir, ces ouvriers, même pour de courts instants parce que fatigués, pourront se recueillir avec Dieu, ils trouveront l’unité avec Lui : ils la trouvent parce qu’ils ont vécu tout leur travail en relation avec Lui. Et c’est ce qu’il y a de plus important : être en relation étroite avec Lui. Et c’est, au fond, ce que l’humanité est prête à entendre aujourd’hui : c’est-à-dire que tout l’univers et tout ce qui s’y accomplit, pris dans un sens religieux, puisse se transformer en une grande prière que le monde élève vers Dieu.
Pasquale Foresi (in “Dio ci chiama. Conversazioni sulla vita cristiana” Città Nuova, 2003, p.116)
Ce matin, il m’a semblé que je m’étais rapproché de Dieu. Jamais, je crois, je ne l’avais senti aussi proche. Ma joie a été et reste grande. Je sens que j’ai trouvé un libre accès pour aller à Lui ; et mon intention est de ne plus jamais m’éloigner. J’ai surmonté, par la grâce de Dieu, les obstacles qui m’empêchaient de m’accrocher à la terre. Désormais, je suis sur terre et j’habite au ciel (mon ambition est grande, mais Sa miséricorde l’est encore plus. Je l’aime infiniment). Les impulsions de vanité, de préférences dans les amitiés ne me freinent plus. Je vais directement à Dieu, en me débarrassant de ces oripeaux. Les hommes peuvent me trahir, me calomnier, me tuer : mais j’ai Dieu, et je les aime indépendamment d’eux. J’appartiens à Dieu. Je n’ai besoin de rien d’autre.
Igino Giordani (in “Diario di Fuoco“, Città Nuova, 1992, p.196)
Activer les sous-titres français https://youtu.be/nLK39FnIrOw

Juin 16, 2023 | Non classifié(e)
Est publié aujourd’hui le premier épisode du nouveau podcast produit par United World Project. Il raconte des histoires d’acteurs de changement – changemakers ayant décidé de se lancer dans une activité nouvelle, sous le coup d’une étincelle qui les a poussés d’agir pour rendre leur société meilleure.
Une étincelle peut inspirer le changement
 Aujourd’hui, 16 juin 2023, United World Project est heureux de vous présenter un nouveau podcast en anglais: Sparks (Étincelles). Dans chaque épisode, nous raconterons des histoires de changemakers, de différentes parties du monde, qui ont donné vie à un projet, une entreprise ou une activité, après avoir été inspirés par une « étincelle »: une petite lumière qui a occasionné la contagion de beaucoup d’autres personnes. Chacune d’elles, chacun d’eux nous emmènera dans son pays, pour nous plonger dans sa culture et nous raconter comment son projet a commencé. Il n’est pas besoin d’être Greta Thunberg ou Ghandi pour engager un changement. Nous croyons que chacun de nous peut faire la différence. Peut-être à peine une étincelle suffit-elle !
Aujourd’hui, 16 juin 2023, United World Project est heureux de vous présenter un nouveau podcast en anglais: Sparks (Étincelles). Dans chaque épisode, nous raconterons des histoires de changemakers, de différentes parties du monde, qui ont donné vie à un projet, une entreprise ou une activité, après avoir été inspirés par une « étincelle »: une petite lumière qui a occasionné la contagion de beaucoup d’autres personnes. Chacune d’elles, chacun d’eux nous emmènera dans son pays, pour nous plonger dans sa culture et nous raconter comment son projet a commencé. Il n’est pas besoin d’être Greta Thunberg ou Ghandi pour engager un changement. Nous croyons que chacun de nous peut faire la différence. Peut-être à peine une étincelle suffit-elle !
Le premier épisode : Giving back to society one jar at a time
Restituer à la société, pas à pas. Nous avons tous de grands rêves. Celui de Mabih était de travailler aux Nations Unies et pendant des années, elle a tout fait pour y parvenir. Mais cela n’a pas été comme elle l’espérait. En 2019, elle a réalisé que son rêve, poursuivi en vue d’aider les autres, n’était peut-être qu’un désir personnel de pouvoir s’affirmer dans la société. Ainsi, en laissant à ce rêve la possibilité de se transformer, sa vie a changé d’une manière jamais imaginée auparavant. Aujourd’hui, à 38 ans, Nji Mabih est à la tête d’une petite entreprise et vit au Cameroun. Pour continuer à lire, cliquez ici. Pour écouter l’épisode immédiatement sur Spotify, cliquez ici ! Si vous préférez écouter des podcasts sur d’autres plateformes, vous pouvez également trouver “Sparks” sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music et Audible. Bonne écoute!
Laura Salerno

 assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? » Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la
assure le pape François, « ne doivent pas être résolues par des interventions du magistère » (Exhortation apostolique Amoris laetizia, n° 3), l’écoute du sensus fidelium de l’ensemble du peuple de Dieu (pasteurs et fidèles) dans la variété des cultures qui le composent est décisive. Le dialogue entre la théologie et le droit est donc animé par une démarche sincère d’inculturation, sans laquelle le risque est réel de poser les bases d’une méprise pratique des principes généraux énoncés par l’Église. « La question, souligne le professeur Vincenzo Di Pilato, coordinateur académique du CEG, est précisément celle-ci : comment rendre effective la participation active de tous les fidèles à nos assemblées synodales ? Restera-t-elle seulement consultative ? Ou sera-t-elle aussi délibérative ? S’agira-t-il de négocier une “concession” juridique ou de “reconnaître” la capacité de décision du sujet collectif de l’action ecclésiale telle qu’elle ressort de l’ecclésiologie de Vatican II et du magistère postconciliaire ? Et sera-t-il donc nécessaire de mettre à jour le Code de droit canonique ? » Dans son message d’ouverture aux participants, le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode, a souligné comment le chemin synodal entre dans une nouvelle phase : il est appelé à devenir une dynamique génératrice et non pas simplement un événement parmi d’autres. On ne peut en effet écouter l’Esprit Saint sans écouter le peuple saint de Dieu dans cette “réciprocité” qui constitue le “Corps du Christ”. C’est dans ce lien communautaire que prend forme cette méthodologie particulière de la  conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode.
conversation dans l’Esprit, bien décrite lors de la présentation de l’Instrumentum laboris. D’où la nécessité – rappelée à plusieurs reprises par le Cardinal Grech – de mieux articuler le principe de la restitution. En d’autres termes, cela signifie que l’unité du processus synodal est garantie par le fait qu’il revient à son point de départ, à l’Église particulière, et qu’il constitue un moment important de “reconnaissance” de ce qui a mûri dans l’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église d’aujourd’hui. Le chemin synodal apparaît donc comme un moment significatif de la vie de l’Église, capable de stimuler et d’activer l’élan créatif et la proclamation évangélique qui naissent de la redécouverte de la relation avec Dieu qui innerve la relation entre les croyants, et aussi comme un signe pour un contexte culturel dans lequel il y a un cri silencieux de fraternité dans la recherche du bien commun. Si dans le rapport « Les problèmes de synodalité entre ecclésiologie et droit canonique » du Prof. Severino Dianich, la récupération de l’ecclésiologie paulinienne de l’être-corps du Christ et la valorisation de la co-essentialité dynamique des dons hiérarchiques et charismatiques ont émergé ; pour le Prof. Alphonse Borras, ce tournant nécessite une explication canonique, qui esquisse une praxis procédurale flexible, capable d’accompagner les processus décisionnels et participatifs à travers les différents organismes déjà prévus (conseil épiscopal, presbytéral, pastorale diocésaine, pastorale paroissiale…). Le cardinal Francesco Coccopalmerio, ancien président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s’est inscrit dans cette ligne lors de son intervention « Synodalité ecclésiale : un passage rapide du consultatif au délibératif est-il envisageable ? » Selon lui, il est possible de trouver dans le droit canonique une définition claire de la synodalité, entendue comme « communion des pasteurs et des fidèles dans l’activité de reconnaissance de ce qu’est le bien de l’Église et dans la capacité de décider comment mettre en œuvre le bien identifié ». A l’issue du séminaire, la proposition a été faite par beaucoup de mettre à disposition les résultats obtenus par la publication des interventions. Le CEG y travaille déjà afin que cela advienne d’ici septembre en tant que contribution supplémentaire au prochain Synode. 

 La diffusion récente du
La diffusion récente du 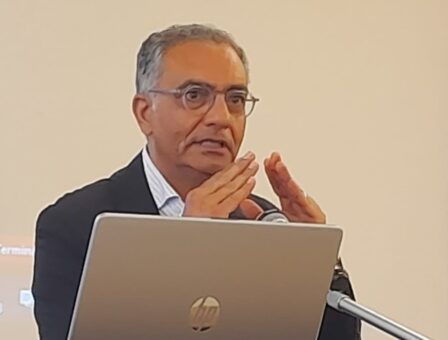 « Il est nécessaire de rendre visible et de souscrire à un engagement concret et universellement partagé », explique Fadi Chehadé, ancien PDG de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et promoteur du « serment » pour une éthique du monde numérique, professeur invité à l’Institut Sophia, « avec lequel les développeurs, les techniciens et les utilisateurs des technologies numériques peuvent fermement ancrer leur travail sur une approche centrée sur l’humain ». Fadi Chehadé a accompagné les premières étapes du parcours depuis novembre 2019, lorsqu’un premier groupe s’était réuni à Trente (Italie) pour donner forme au projet. Par la suite, le groupe promoteur a impliqué des chercheurs de différents pays et a participé à la consultation publique promue par l’ONU pour le Global Digital Compact 2024.
« Il est nécessaire de rendre visible et de souscrire à un engagement concret et universellement partagé », explique Fadi Chehadé, ancien PDG de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et promoteur du « serment » pour une éthique du monde numérique, professeur invité à l’Institut Sophia, « avec lequel les développeurs, les techniciens et les utilisateurs des technologies numériques peuvent fermement ancrer leur travail sur une approche centrée sur l’humain ». Fadi Chehadé a accompagné les premières étapes du parcours depuis novembre 2019, lorsqu’un premier groupe s’était réuni à Trente (Italie) pour donner forme au projet. Par la suite, le groupe promoteur a impliqué des chercheurs de différents pays et a participé à la consultation publique promue par l’ONU pour le Global Digital Compact 2024.
